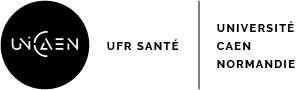Depuis sa création en 2006, le Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (CIREVE) a acquis une solide expertise sur l’usage de la réalité virtuelle en santé. Au fil des années, le centre a accompagné de nombreux laboratoires et start-up du territoire, dans des projets innovants. Fort de ce savoir-faire, le CIREVE a organisé une université d’été internationale du 25 au 27 août 2025, dédiée aux apports de la réalité virtuelle dans les domaines de la santé, de la rééducation, du vieillissement et de la performance. L’occasion de faire le point sur deux projets actuellement en cours au laboratoire COMETE.
« Explorer la diversité des trajectoires de vieillissement » · Julien Rossato, chercheur postdoctorant au laboratoire COMETE
« En 2040, selon l’Insee, plus d’un quart de la population française aura 65 ans ou plus. Le vieillissement s’accompagne souvent d’une plus grande fragilité, les risques de chute ou de développer une maladie neurodégénérative étant plus élevés. Pourtant, le vieillissement ne conduit pas toujours à un état de dépendance. Certaines personnes connaissent un « vieillissement réussi », avec une faible probabilité de maladies, un maintien des capacités physiques et cognitives et un engagement actif dans la société.
C’est pour étudier cette diversité des trajectoires de vieillissement que j’ai rejoint le laboratoire COMETE en juin 2025. Mon travail porte sur le traitement des données recueillies entre 2019 et 2023 auprès de 100 personnes âgées de 55 ans et plus, dans le cadre du projet PRESAGE. Une partie du protocole s’est déroulée au CIREVE, qui dispose de caméras infrarouges et d’un tapis de marche pour mesurer finement les paramètres du mouvement. Les participants et participantes devaient marcher sur ce tapis, tout en effectuant une tâche cognitive de difficulté croissante – un protocole dit « de double tâche », conçu pour mobiliser simultanément les fonctions exécutives et attentionnelles. Comment s’organise-t-on face à cette double contrainte ? Le ralentissement de la vitesse de marche, les hésitations ou encore les écarts traduisent le contrôle que l’individu a eu besoin d’exercer pour éviter la chute.
Ces caractéristiques de performance sont ensuite croisées avec les questionnaires remplies par les participants, qui nous renseignent sur leur niveau d’éducation, sur leur engagement actuel et passé dans des activités intellectuelles, physiques et culturelles, et sur la qualité de leur réseau social. Notre hypothèse, c’est que l’évolution vers un trouble neurocognitif peut être modulée par la « réserve cognitive » : cette capacité du cerveau à compenser les effets du vieillissement ou des lésions cérébrales, façonnée tout au long de la vie, jouerait un rôle protecteur contre le déclin cognitif.
À terme, il s’agit de caractériser les trajectoires de vieillissement, afin de repérer le plus tôt possible les personnes à risque de développer des troubles neurocognitifs et de permettre des interventions préventives personnalisées pour préserver leur autonomie. »

« Détecter les signes de fragilité avant même l’apparition des premiers symptômes de troubles neurocognitifs » · Baptiste Perthuy, doctorant au laboratoire COMETE
« Après avoir obtenu mon master Neurosciences en 2023, j’ai démarré une thèse au laboratoire COMETE, sous la direction de Leslie Decker. Mes travaux se concentrent sur le syndrome dit « du risque cognitivo-moteur » (MCR) qui touche environ, à travers le monde, 10% des personnes âgées de plus de 60 ans. Ce syndrome se définit par la combinaison de deux caractéristiques : une vitesse de marche ralentie et une plainte cognitive subjective (problèmes de concentration, de mémorisation etc.) L’association de ces deux signes est préoccupante car elle est associée à un risque accru de chute, de perte d’autonomie et d’évolution vers des troubles neurocognitifs majeurs : le risque de développer une maladie neurodégénérative de type Alzheimer est multiplié par deux, et le risque de développer une démence vasculaire est multiplié par douze. Or ces signes peuvent apparaître jusqu’à quinze ans avant les tout premiers symptômes cliniques de la maladie – d’où la nécessité de repérer les signes précoces de fragilité et d’agir tôt pour proposer le meilleur accompagnement possible.
La marche, loin d’être un simple automatisme, nécessite l’action coordonnée de systèmes complexes. Elle est étroitement liée aux fonctions exécutives du système nerveux central. La simple observation de la marche donne ainsi des clés pour détecter précocement des troubles neurologiques latents. Un de mes objectifs est d’identifier les biomarqueurs moteurs, dans une perspective d’évaluation et de suivi de personnes âgées à risque de troubles neurocognitif. Pour ce faire, je travaille, tout comme Julien Rossato, sur les données du projet PRESAGE, auquel j’ai participé durant mon stage de master 2.
Mais détecter ces signes en pratique clinique reste difficile. C’est pourquoi l’entreprise a-gO, créée par Alexandre Dalibot et Hugues Vinzant, développe actuellement une solution de capture et d’analyse du mouvement, facilement déployable en contexte clinique. Ma thèse, en contrat Cifre avec a-gO, vise à valider ce système innovant basé sur l’intelligence artificielle. À partir de vidéos enregistrées par trois iPhone lors d’un test standardisé de marche de cinq minutes sur tapis roulant, l’intelligence artificielle génère un jumeau numérique 3D précis de la locomotion. Un module d’analyse automatique traite ensuite ce jumeau numérique afin d’extraire des biomarqueurs moteurs de la marche. Ces biomarqueurs fournissent des informations objectives permettant d’établir un véritable profil neurocognitif de la personne et d’en suivre l’évolution dans le temps. L’intelligence artificielle vient accélérer le diagnostic et fiabiliser le suivi. À terme, cette technologie pourrait être utilisée par les professionnels de santé pour un diagnostic précoce, un suivi personnalisé et une meilleure prise en charge sur le long terme. »